|
Avant-propos.
Comme
pour beaucoup de villes importantes situées sur les
frontières du nord et de l'est, les hauteurs dominant
Grenoble sont occupées par des forts qui en assuraient
la défense.
Citadelles
oubliées d'un désert de tartares aux portes
de la ville, les forts de Grenoble, qui attendirent en vain
d'accomplir les missions pour lesquelles ils avaient été
construits, furent édifiés à la fin
du XIXème siècle. Ils assuraient la continuité
défensive des enceintes bastionnées qui avaient
protégé la ville durant trois siècles
et appartenaient à un système général
cohérent issu d'une évolution de l'armement
qui remettait en cause les préceptes de défense
acquis jusqu'à ce moment là. Confirmant une
fois encore, l'éternelle lutte entre l'épée
et le bouclier. Ce changement tactique fondamental était
la conséquence de l'évolution des techniques
d'armement qui avaient trouvé un point d'orgue, provisoire,
avec l'apparition au cours de la décennie commencée
en 1850 du canon rayé.
L'évolution
des techniques.
Après
plusieurs siècles au cours desquels l'évolution
de l'armement ne porta que sur des changements mineurs,
c'est au milieu du dix neuvième siècle qu'une
amélioration particulièrement importante de
l'armement va modifier totalement l'aspect des systèmes
défensifs. Au cours de la décennie commencée
en 1850 apparaît le canon rayé qui augmente
la vitesse, la précision et la portée des
projectiles : 6 km au lieu de quelques centaines de mètres
peu d'années auparavant.
Autant
de nouvelles données qui rendent obsolètes
les fortifications bastionnées, dont les préceptes
datent bientôt de trois siècles, que pourtant
l'on construisait encore dans les années 1840 et
pour lesquelles subsistaient encore à ce moment là
de nombreux partisans.
Des
précurseurs.
Les
arguments qui pouvaient être opposés aux tenants
de la fortification bastionnée étaient pourtant
nombreux et avaient déjà eu un siècle
plus tôt un partisan de choix puisqu'il s'agissait
du Marquis de Montalembert - 1714 - 1800.
Deux orientations essentielles permettent de se faire une
idée des divergences :
La première
est de considérer que le point faible de la place
bastionnée est dûe à la position de
l'artillerie, qui mise en batterie à l'air libre
sur des bastions, peut être facilement détruite.
Afin d'y remédier, Montalembert, prenant exemple
sur les travaux que Dürer - 1471 - 1528
- plus connu comme peintre et graveur que pour ses talents
de fortificateur, auteur pourtant de remarquables
"instructions sur la fortification des villes, bourgs
et châteaux" publiées en 1527 à
Nuremberg, envisage après avoir critiqué les
systèmes de Vauban, la fortification "perpendiculaire"
faisant face à l'ennemi par la construction d'enceintes
au tracé polygonal comprenant des ouvrages casematés
ventilés dans lesquels sera dissimulée l'artillerie.
Pour
la seconde, certainement la plus contestée par les
officiers du Génie, Montalembert envisage les progrès
que pourrait faire l'artillerie et préconise de construire
des ensembles fortifiés à l'extérieur
des villes, en barrant les voies d'accès, d'ouvrages
dont les feux s'épauleraient.
|
|
|
Reproduction
des ouvrages de défense proposés par
Albert Dürer dans "l'instruction sur la
fortification des villes, des bourgs et des châteaux"
paru en 1527 à Nuremberg et réédité
en 1870 à la suite d'une traduction historique
et critique de A. Ratheau, chef de bataillon du Génie.
Les
dessins représentent l'élévation
des façades et une coupe d'un "tourrion"
que Dürer proposait d'édifier en périphérie
des villes pour les protéger. On ne peut s'empêcher
de rapprocher ces vues en élévation,
aussi bien pour l'extérieur que pour les coupes
intérieures, des forts édifiés
au XIXème siècle.
|
Ces innovations, provenant d'un officier ayant choisi comme
arme l'artillerie n'eurent pas l'aval des officiers du Génie
de l'époque à qui elles apparaissaient comme
dépassées. Il est nécessaire à
ce sujet de préciser que ce rejet n'était
pas sans raison, puisque les forts que l'on proposait s'érigeaient
tels des châteaux forts et n'étaient pas encore
dissimulés, comme cela sera le cas après 1870.
Refusées
en France, les théories de Montalembert, qui
pouvaient s'appliquer aussi bien à la défense
des villes qu'à celles des voies de communication.
ne reçurent pas l'accueil qu'elles auraient mérité
et hormis quelques essais autour des ports de guerre entre
autre à Toulon au mont Faron elles furent en France,
en général rejetées cependant qu'à
l'étranger elles trouvaient quelques applications,
notamment après sa mort par la construction en Savoie
- alors sous la dépendance Austro-Sarde -
du barrage de l'Esseillon dont les travaux s'échelonnèrent
de 1820 à 1833. Et le principe en sera repris, plus
tard, après que l'on eut abandonné l'idée
de construire des tours.
On le
voit, les polémiques autour des fortifications et
des systèmes de défense sont de toutes les
époques et se poursuivront dans les années
1860 au delà des frontières, lorsqu'un officier
allemand, M. de Zastrow, trouva que Montalembert
s'était fortement inspiré de Dürer.
Cependant, pour compléter une vision imparfaite de
la situation des systèmes défensifs de cette
période, il faut savoir que la fin du dix huitième
siècle et le début du dix neuvième
furent surtout marqués par l'évolution de
la poliorcétique liée à
l'utilisation de l'artillerie montée, consécutive
à l'allégement des canons, dûe à
Gribauval, dont l'efficacité est démontrée
par les campagnes de
la Révolution puis de l'Empire.
|
Les
photographies de cette page représentent les
forts de l'Esseillon en Savoie.
Sur
la photo ci-contre au premier plan : la Redoute Marie-Thérèse
et au-dessus des rochers surplombant une impressionnante
paroi à pic : le fort Victor-Emmanuel, lui-même
dominé par le fort Charles Félix.
|
|
|
|

La
photo latérale représente la redoute
Marie-Thérèse avec ses importantes embrasures
à canons, avant que ne soient entrepris les
très importants travaux de restauration dont
les forts de l'Esseillon sont l'objet.
|
Les
premiers forts de ceinture.
En 1830,
malgré les divergences d'opinion entre les tenants
de la fortification bastionnée et les novateurs,
souvent aggravées par les échos provenant
de l'étranger, Adolphe Thiers en accord avec
Louis-Philippe fera entreprendre à Paris la
construction des forts de ceinture et c'est quelques années
plus tard, de 1840 à 1845 que furent édifiés
les seize forts protégeant Lyon.
L'évolution
stratégique.
Ces
divergences ne sauraient faire passer sous silence deux
autres raisons de la désaffection de la fortification
bastionnée qui malgré tout sera conservée
autour des villes qui en sont dotées pour assurer
un réduit de défense en cas d'attaque soudaine.
La première
est en partie dûe au mode de recrutement qui va voir
le jour après 1871. Le Service Militaire rendu
obligatoire permettra d'avoir sous les drapeaux autant d'hommes
que l'on souhaitera, et d'aligner devant une enceinte bastionnée
une armée suffisamment importante pour en faire le
siège.
Pour
la seconde le réduit bastionné délimite
en effet un espace restreint dans lequel ne peuvent se mouvoir
des réserves de troupes permettant d'organiser une
contre offensive. Et il peut être très facilement
pris sous les feux concentrés des batteries ennemies
empêchant toutes sorties.
Dès
lors, l'avantage de la fortification par forts détachés
devient incontestable, puisque tout en assurant la défense
des points de passages obligés, il permet de préparer
sur des plus grands espaces tout en les dissimulant aux
assiégeants des troupes de contre-attaque.
Cependant
la somme de connaissances qu'avaient les officiers du Génie
et de l'Artillerie ne servit pas à grand chose. Puisque
la guerre de 1870 consécutive à des erreurs
diplomatiques, suivie par une défaite causée
par l'impréparation de l'armée française,
démontra que le renforcement des fortifications existantes
et l'apport de quelques forts détachés ne
correspondaient plus à une protection suffisante.
Toutefois
l'expérience acquise au cours de cette guerre, mais
surtout après celle-ci, alors que Séré
de Rivières commandait les forces versaillaises
qui s'empareront des forts de Paris tenus par la Commune
permettra aux spécialistes du Génie de dégager
les principes d'une modification de ces ouvrages et de notre
défense.
Le
système Séré de Rivières".
Le système
Séré de Rivières, la plus importante
organisation de défense jamais élaborée
jusqu'alors dans notre pays - puisque pour les frontières
du Nord et de l'Est pas moins d'environ cent quatre vingt
dix forts et petits ouvrages, ainsi que plus de deux cent
cinquante batteries seront construits contre vingt six places
fortes édifiées et une quarantaine remaniées
par le grand Vauban - qui constituera un nouveau
"pré carré" découle
des principes suivants:
 Couvrir sur chaque frontière, la mobilisation, la
concentration et les formations de combat des armées.
Couvrir sur chaque frontière, la mobilisation, la
concentration et les formations de combat des armées.
 Canaliser les débouchés de l'attaque ennemie
en des points de passage obligé.
Canaliser les débouchés de l'attaque ennemie
en des points de passage obligé.
 Soustraire le plus possible le sol national aux premières
opérations.
Soustraire le plus possible le sol national aux premières
opérations.
 Barrer les voies ferrées.
Barrer les voies ferrées.
 Créer une deuxième ligne de défense
en prévision d'une rupture de la première.
Créer une deuxième ligne de défense
en prévision d'une rupture de la première.
 Fortifier les objectifs principaux de l'ennemi.
Fortifier les objectifs principaux de l'ennemi.
Ces
principes entraîneront la création de rideaux
défensifs de 60 à 80 km de longueur, constitués
d'ouvrages :
 assez rapprochés pour que les feux de l'artillerie
se croisent,
assez rapprochés pour que les feux de l'artillerie
se croisent,
 assez forts pour exiger un siège,
assez forts pour exiger un siège,
 assez petits pour être défendus par peu de
soldats,
assez petits pour être défendus par peu de
soldats,
 et utilisant au maximum les difficultés du terrain.
et utilisant au maximum les difficultés du terrain.
Ces
rideaux seront donc constitués de forts au tracé
polygonal, dont les faces susceptibles d'être attaquées
seront protégées par des levées de
terre ou inscrite dans le profil du site. Ils comporteront
deux crêtes de feux concentriques, l'une pour l'artillerie
et l'autre pour les combats rapprochés réservés
à l'infanterie dont les défilements auront
été particulièrement étudiés.
Les
pièces d'artillerie seront installées à
ciel ouvert entre des traverses-hautes maçonnées,
couvertes de terre, qui les protégeront contre les
coups d'enfilade et les éclats d'explosion des projectiles,
et dont l'intérieur servira d'abri pour les servants
des pièces et de magasin pour le matériel
et les munitions.
Le flanquement
des fossés sera assuré par des pièces
d'artillerie placées d'abord à l'intérieur
de caponnières, puis plus tard dans des coffres de
contrescarpe. Ces forts comprendront de nombreuses constructions
- casernements, magasins, poudrières, etc...
- recouvertes par des maçonneries en voûtes
d'environ un mètre d'épaisseur, elles-mêmes
protégées par une couche de terre de plusieurs
mètres. Ces principes de défense resteront
valables pendant de nombreuses décennies. Dès
lors, ils seront repensés. Protégés
par des cuirassements et du béton et dotés
de tourelles en acier pour l'artillerie.
| La
carte ci-contre représente la frontière
de l'est de la France après la guerre de 1870,
avec, entourées de cercles rosés, les
zones d'implantation des forts du système défensif
conçu sous l'égide de Séré
de Rivières.
|
|
|
|
"Les
forts de Grenoble au XIXème siècle"
|
|
Le
Général Séré de Rivières.
Né
le 20 Mai 1815 à Aibi - Tarn - celui-ci sera,
après de longues études, reçu
en 1835 à Polytechnique d'où il sortira
en 1837 dans l'arme du Génie. Il prendra part
aux campagnes d'Afrique en 1841 et 1842 pour rentrer
en France en 1843 où il dirigera à Toulon
d'importants travaux.
Capitaine
au 1er Régiment du Génie, il deviendra
membre du Comité des Fortifications en 1848.
Chef de bataillon en 1858 au début de la campagne
d'Italie, il commandera la 8ème Division du
1er Corps du Génie à la tête duquel
il sera grièvement blessé et fait Officier
de la Légion d'Honneur.
|
|
 |
|
A partir de 1861, après le rattachement de
la Savoie et du Comté de Nice à la France,
il réorganisera la nouvelle frontière
des Alpes, puis responsable de l'organisation du front
retranché de Metz avant d'être nommé
Directeur du Génie de Lyon en 1867 dont il
prépara la défense.
Général
en 1870, il commandera successivement le Génie
de la 1ère armée de la Loire, de l'armée
de l'Est puis le 2ème corps d'armée
de l'armée de Versailles.
Membre
du Comité de Défense en 1872 sous la
présidence du Maréchal Mac-Mahon, général
de division en 1874 et directeur du service du Génie
au Ministère de la Guerre, il entreprendra
l'élaboration du système de protection
des frontières qui portera son nom et sera
élevé à la dignité de
Grand Officier de la Légion d'Honneur.
Puis
en 1879 la victoire au sénat du parti Républicain,
entraînera l'épuration des cadres de
l'armée en majorité monarchistes. Et,
était-ce son comportement d'une cruelle intransigeance
lors de la chute de la commune, ou des investissements
de défense, considérés comme
outranciers par le gouvernement, il fût invité
à présenter une demande de mise en disponibilité.
Et il ne termina jamais le système de défense
qu'il avait imaginé, conçu, et commencé
de réaliser.
|
| |
Caractéristiques
générales.
S'ils
sont de formes différentes tous ces forts, pour s'adapter
aux sites sur lesquels ils sont édifiés et
aux missions qui leur étaient dévolues, sont
construits sur un plan sensiblement identique.
Par
leur conception, exempte encore des protections procurées
par les vastes chapes bétonnées et des tourelles
d'artillerie nécessités au moment de l'invention
de l'obus torpille, ils appartiennent à une première
série mise au point après 1870 par le commandement
du Génie. Entourés de profonds fossés
ils comportent souvent un corps de bâtiment central
ayant la forme d'un V largement ouvert qui assure une meilleure
protection aux coups et permet la multiplication des angles
de tirs. Ce bâtiment était destiné au
logement de la troupe, le plus souvent en chambrées
de quarante hommes, appelées communément casemates.
Le noyau
central était épaulé de part et d'autre
par des bâtiments plus petits pour recevoir le logement
des officiers, abriter divers services : cuisine, four
à pain, infirmerie, magasin pour le matériel
d'entretien, les communications, poudrières et munitions.
L'ensemble
de bâtiments ainsi constitué, s'ouvrait sur
une cour centrale où s'effectuaient les exercices
dont la vie militaire est émaillée. Cette
cour pouvait communiquer avec l'extérieur par l'intermédiaire
d'un petit bâtiment de garde dont la porte était
équipée d'un pont-levis permettant de franchir
le fossé.
Les
bâtiments à un ou plusieurs niveaux étaient
constitués d'alvéoles couvertes en maçonnerie
voûtée de l'ordre d'un mètre d'épaisseur,
protégées par des chapes ciment ayant forme
de pente pour diriger les eaux d'infiltrations vers des
exutoires intérieurs et extérieurs permettant
leur récupération dans des citernes. Au-dessus
de ces voûtes prenaient place, espacées d'une
vingtaine de mètres, des alvéoles également
voûtées couvertes en maçonnerie de même
épaisseur. Ces alvéoles nommées "traverses-abris"
servaient pour abriter les servants des pièces d'artillerie,
le matériel et les munitions et, pour certaines,
de communiquer avec l'intérieur du fort par des escaliers.
|
|
|
Le
plan de masse du fort du Mûrier est, par sa
forme particulièrement pure, un exemple d'école
des forts construits après 1871 et avant l'intervention
de l'obus torpille.
|
L'ensemble de ces ouvrages était couvert par de grandes
levées de terre de plusieurs mètres d'épaisseur
qui étaient modelées et engazonnées
de manière à assumer le double rôle
de protection pour les coups directs et de pare-éclats
mais également de permettre la mise en batterie des
pièces d'artillerie dont le fort était doté.
Les levées de terre qui remplissaient ce rôle
de protection se prolongeaient sur la façade extérieure
des bâtiments jusqu'au bas du chemin de ronde soutenu
par le mur d'escarpe. C'est ce système de protection
qui donne le nom de casemate aux locaux de ces bâtiments.
Les
terres des parois du fossé étaient maintenues
en place par des murs de soutènement, côté
intérieur par celui d'escarpe et vers l'extérieur
par celui de contrescarpe.
Au niveau
du fossé, la protection rapprochée était
parfois assurée côté mur d'escarpe par
l'exhaussement de celui-ci, au-dessus du chemin de ronde
et le percement dans cette partie de mur - dit à
"la Carnot" - de meurtrières permettant
l'installation de tireurs aux fusils.
|
|
|
Coupe et façade schématique des forts
de la première génération permettant
d'apprécier l'important masse de terre de protection
accumulée entre les fossés et les casemates.
|
|
|
|
Mur
d'escarpe comportant des meurtrières pour tir
au fusil et des embrasures pour grenadage.
|
Les
caponnières, coffres d'escarpe et de contrescarpe.
Primitivement,
caponnière désignait dans la fortification
bastionnée un passage protégé permettant
de franchir le fossé entre la courtine de l'enceinte
et une demi lune. La protection pouvait être complète,
tel un tunnel, ou simplement constituée de glacis
disposés de part et d'autre d'un couloir à
ciel ouvert.
Les
caponnières de nouveau type qui apparurent au XIXème
siècle sont autrement plus élaborées
et constituent des sortes de bastionnets avancés
par rapport au mur d'escarpe. Elles pouvaient être
simples lorsque leurs feux flanquaient un seul côté
de fossé et doubles, lorsqu'elles flanquaient des
feux de leurs canons à balles puis de leurs mitrailleuses
des fossés opposés. Entre autres caractéristiques,
elles pouvaient être également munies, tels
les châteaux du Moyen âge pour la défense
rapprochée, de sorte de mâchicoulis surplombant
le fossé qui sont des trémies de grenadage.
Elles pouvaient être prolongées de part et
d'autre par des coffres d'escarpe comportant également
des embrasures de tirs. Ce système assez fragile,
puisque les façades sont sans protection de terre,
disparaîtra après les modifications des projectiles
et laissera la place à des coffres de contrescarpe
auxquels on accédait par des tunnels.
L'artillerie
et son fonctionnement.
Le
"nombre d'or" de la fortification, la portée
de l'artillerie.
Véritable raison d' être des forts, l'artillerie de forteresse
prenait place sur les espaces ménagés entre les traverses
abris protégées par des cavaliers de terre et les banquettes
de tirs.
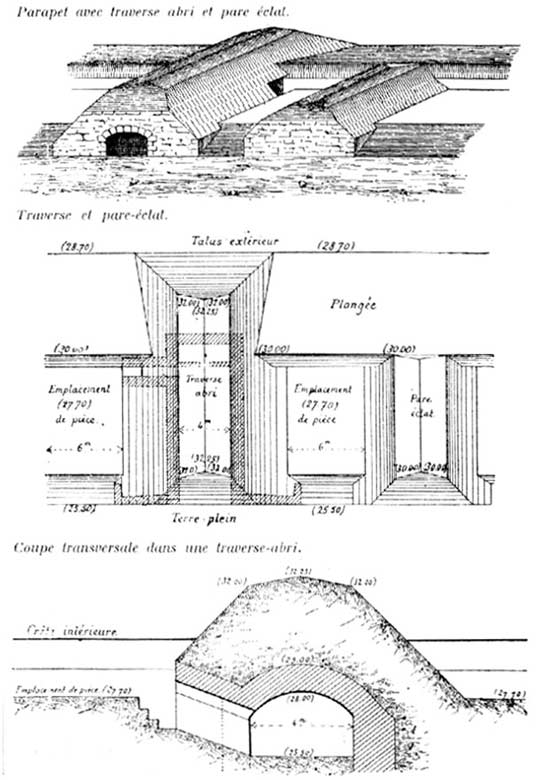
Schéma
de principe d'un emplacement de batterie à ciel ouvert,
sur cavalier d'artillerie…
Levées de terre que sont le parapet ou talus extérieur,
la traverse abri,
le pare-éclat qui protège également
des "tirs d'enfilade",
la rampe d'accès 2/3, de même rapport que les
dimensions du drapeau…
Aucune
écurie n'étant prévue sur place elle
était acheminée par des trains d'équipage
pouvant comporter jusqu'à 10 chevaux par canon. Ces
équipages regagnaient ensuite les casernes de la
ville. Une fois sur place les pièces d'artillerie,
canons de différents calibres, en fonction des emplacements
de tirs étaient, pour les grosses pièces de
155 ou de 120, disposées sur un plancher bois reposant
sur des chevrons, de manières à ne pas s'enfoncer
dans les terres de protection
|
|
|
Canon
de 155 et les servants nécessités pour
l'utilisation de cette pièce d'artillerie dont
le poids était de 2 235 kgs , posée,
afin d'assurer sa stabilité, sur une plate-forme
en bois d'un poids de 2 425 kgs. Les obus de 40 kgs
pouvaient atteindre leur cible à environ 7
200 m.
|
Les officiers de tirs positionnaient alors les pièces
en batteries selon des objectifs et des angles de tirs déterminés
à l'avance en fonction des points de passages obligés
de l'ennemi éventuel. La cadence de tir ne dépassait
pas un coup toute les deux minutes.
Flanquement
des fossés.
Outre
l'armement individuel, le flanquement des fossés
pouvait être assuré depuis les caponnières
ou coffres de contrescarpe par des canons à balles.
Cette bouche à feu - que l'on peut considérer
comme annonçant la mitrailleuse - était
composée de 25 tubes en acier entourés d'une
enveloppe en bronze. Les tubes de calibre 13 mm. étaient
rayés et chargés ensemble alors que le tir
était déclenché successivement par
25 percuteurs. Il existait également après
1879 un canon revolver constitué de 24 tubes rayés
de pas différents permettant de couvrir par un feu
de salve toute une longueur de fossé.
|
|
|
Canon
à balles conçu par le Capitaine Reyffye,
aide de camp de Napoléon III.
|
Magasins à poudre.
Avant
1885, les forts ne contenaient comme munitions préparées
à l'avance, que les cartouches destinées aux
armes individuelles. Ces ouvrages devaient donc posséder
des locaux destinés aux magasins à poudre,
des dépôts de gargousses, de projectiles,
des ateliers de préparation des munitions, mais également
des magasins de matériel et des ateliers de réparations.
Les
magasins à poudre se devaient d'être facilement
accessibles depuis les lieux de préparation, mais
également d'être établis de manière
à assurer une protection contre les coups de l'ennemi,
de façon à mettre la poudre à l'abri
de l'humidité. Ils sont en général
de forme rectangulaire avec des murs d'environ 1,00 m d'épaisseur,
couverts par une voûte de même épaisseur,
laquelle est surmontée de plusieurs mètres
de terre assurant une protection efficace
Le
plancher bas est en général construit en hourdis sur poutrelles
métalliques revêtu d'une chape hydrofuge faite avec un mastic
bitumineux. Au-dessus de ce premier plancher, un parquet
en chêne sur lambourdage permet d'assurer une double circulation
d'air. Afin d'éviter tout risque d'étincelles, toutes les
pièces métalliques sont faites en cuivre ou en zinc. La
ventilation est assurée par des ouvertures débouchant dans
des cheminées protégées extérieurement par des claims,
ainsi que par des ouvertures latérales en chicane permettant
les entrées d'air.
| L'éclairage
artificiel bien nécessaire était obtenu
par des lampes à réflecteurs - type celles
utilisées par les chemins de fer, elles étaient
mises en place dans des chambres d'éclairage
aménagées dans l'un des couloirs de desserte
et qui ouvraient avec des verres dormants sur l'intérieur
de la poudrière.
Enfin les magasins à poudre étaient
surmontés de paratonnerres dont les tiges amovibles
étaient enlevées en temps de guerre.
La poudre était enfermée dans des caisses
en zinc d'une contenance de 50 kg et recouvertes dans
une enveloppe en bois.
|
|
| Intérieur
d'une poudrière : en partie basse, trace du plancher
support alors que s'ouvrent en haut du mur frontal la
ventilation haute et de part et d'autre les chambres
d'éclairage. |
|
Afin
d'assurer au maximum la sécurité, la poudrière ne communique
pas directement avec les autres magasins ou ateliers de
préparation mais seulement par l'intermédiaire de couloirs
ou de vestibules.
Les
dépôts de gargousses et de projectiles
chargés étaient installés à
proximité des remparts d'utilisation et donnaient
parfois lieu à l'établissement d'une traverse
abri communiquant avec l'intérieur par une gaine
verticale équipée d'un monte charge manuel.
Les
Transmissions.
Si l'artillerie
était essentielle, l'autre point important concernait
les communications, indispensables au bon fonctionnement
de l'ensemble défensif.
Tout
au début les transmissions étaient assurées
par le télégraphe optique dont les
portées variaient en fonction des types d'appareils.
Pour les plus performants destinés à être
placés dans les forteresses, les portées pouvaient
atteindre 120 km. Enfin plus tardivement il fut installé
des lignes téléphoniques
|
|
|
Equipe
de transmetteurs autour de l'appareil de télégraphe
optique
|
Afin de pallier toute défaillance éventuelle
du matériel ou de surmonter une période de
mauvais temps, les places importantes étaient équipées
de colombiers militaires relevant également des autorités
locales du Génie. Le service était assuré
par des sapeurs colombophiles qui soumettaient leurs
pensionnaires à un entraînement en pratiquant
des échanges entre les places. Autre particularité
de ce service, les sapeurs colombophiles ont pu vendre la
"colombine" - fiente de pigeon
- à leur profit auprès d'agriculteurs qui
utilisaient ces déjections comme engrais, jusqu'en
1917 ou l'Etat par le ministère de l'agriculture
décida que le produit de ce ramassage devait revenir
à ses caisses et serait désormais attribué
par adjudication publique.
La
vie à l'intérieur des forts.
La vie
à l'intérieur des forts était bien
évidemment différente de celle que pouvait
avoir les soldats à l'intérieur des dernières
casernes construites à la même époque
dans les villes et qui comportaient des chambres à
24 lits, des espaces réfectoires et des lavabos.
Les
forts qui constituaient un point d'appui important du système
défensif ne servaient que de cantonnement passager
à des compagnies destinées à être
relevées périodiquement en cas de conflit.
Bien qu'ayant tout le nécessaire, la vie des officiers
et de la troupe y était très spartiate.
En règle
générale, les parties supposées être
les moins exposées aux feux de l'ennemi abritaient
le commandement, les chambres des officiers, les dépôts
de matériels, de vivres, cuisine, four à pain,
infirmerie et citerne d'eau. La partie se trouvant sous
les traverses-abris constituait les casemates destinées
au logement de la troupe. Chacune des casemates pouvait
abriter 40 hommes.
Cependant,
il n'y a pas de réfectoire, ni même de table,
les soldats qui avaient parfois un tabouret mangeaient dans
leur chambre sur une tablette de bois rabattable qui était
fixée au lit.
Le chauffage
était assuré par des poêles à
charbon en fonte dont l'évacuation des fumées
se faisait souvent par des tuyaux métalliques raccordés
à un trou communiquant avec l'extérieur. Des
systèmes plus perfectionnés de type chauffage
à air chaud avec évacuation de l'air vicié
en partie supérieure verront le jour dans les projets
du Génie, mais ne seront jamais généralisés.
|
|
| Coupe
schématique montrant le système de chauffage
par air chaud, imaginé par le service du Génie
et appliqué au fort de Comboire. Le conduit de
fumée jumelé parcourt la quasi totalité
de la longueur de la casemate dans une gaine maçonnée
munie d'ouvertures au-dessus des lits de manière
à diffuser la chaleur. Cette approche moderne
de diffusion de la chaleur a été souvent
utilisée et avait retrouvé un nouvel essor
dans les années 1960 à partir de poêle
au fuel. |
L'ameublement des casemates ne comprend que des lits à
4 places en plancher de bois, avec tablettes rabattables
pour prendre les repas, et râteliers d'armes
permettant de suspendre les fusils horizontalement. Entre
les lits prennent place des planches à bagages.
Les
cuisines sont assez bien équipées, dotées
de fourneaux fixes avec hottes et cheminées d'évacuation,
leur équipement comprend des marmites permettant
de cuire jusqu'a 800 l. de soupe, des percolateurs permettent
de préparer plusieurs dizaines de litres de café.
Sauf
cas particuliers, les forts comprennent des fours à
pain permettant d'assurer la préparation des rations
quotidiennes de plusieurs semaines.
Les
sous-officiers sont logés dans des chambres analogues
à celles des hommes de troupe, en lits à 2
étages mais seulement 1 place par lit.
Les
officiers sont parfois logés en chambres individuelles
qui servent également de bureau, toutefois lorsque
l'une d'entre elle est disponible, elle sert de salle à
manger dans certains forts. Les officiers, les sous-officiers
et la troupe se nourrissent au même ordinaire.
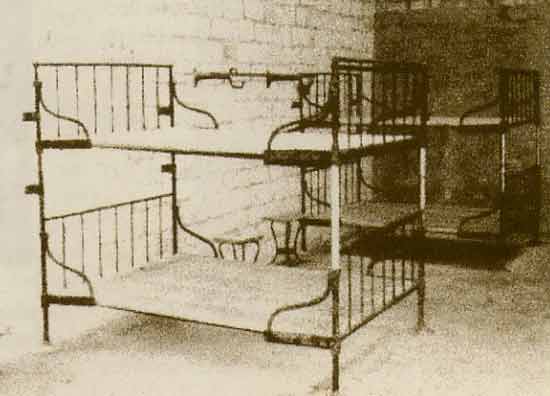
Lit à deux étages pour quatre soldats,
comportant un support en bois sur lequel était
posé un matelas en crin.
Les lits étaient fixés aux murs de la
casemate par des pièces métalliques
que l'on peut encore apercevoir dans certains locaux. |
|
|
| |
|
|
|
|
Lits jumelés
à 4 places sur deux niveaux avec sommiers bois
- reconstitution avec les lits d'époque au
fort du St Eynard.
|
Les zones de servitude.
Enfin,
si ces forts apportaient aux villages à proximité
desquels ils étaient construits un surcroît
d'activité dû à la présence de
la troupe, ils exerçaient une lourde contrainte pour
les terres qui les entouraient par la création de
zones de servitude.
Celles-ci
s'appliquaient, conformément au décret du
10 Aout 1853, sur les propriétés comprises
dans trois zones commençant toutes aux fortifications
et s'étendant respectivement sur des distances de
250 ; 487 ; 584 et 974 m suivant les places, et toute construction
neuve de maisons, clôture et autres bâtisses,
ainsi que toutes réparations, transformations ou
modifications qu'elle qu'aient pu être la cause étaient
soumises à l'avis de l'autorité militaire.
Tout manquement à ces règles pouvait faire
l'objet de procès-verbaux de constatations dressés
par les gardes du Génie et entérinés
par le Maire ou le Juge de paix.
|

